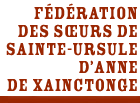Fédération des Sœurs de Sainte-Ursule d'Anne de Xainctonge

Anne de Xainctonge
Œuvres
Les écrits d'Anne de Xainctonge n'ont pas fait l'objet de publication de son vivant. On trouvera mention ou édition des principaux textes qui lui sont attribués dans la Positio (voir infra, choix bibliographique) et dans Marie-Amélie Le Bourgeois, Les Ursulines d'Anne de Xainctonge (voir infra, choix bibliographique).
- 1606-1621: «Instructions que la vénérable Mère Anne de Xainctonge a laissées écrites de sa main en la maison de Sainte-Ursule de Dole, tirées sur l'original l'an 1745», dans Marie-Amélie Le Bourgeois, Les Ursulines d'Anne de Xainctonge, voir infra, choix bibliographique, p.351-400.
Choix bibliographique
- Bernos Marcel, Femmes et gens d'Eglise dans la France classique, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Cerf, 2003, p.117, 182, 192, 207, 316-320.
- Les femmes et l'accès au savoir au temps d'Anne de Xainctonge, Dole 1596-1621, Actes du Colloque de Dole (juillet 1997), Cahiers dolois, 14, 1997.
- Le Bourgeois, Marie-Amélie, Les Ursulines d'Anne de Xainctonge (1606). Contribution à l'histoire des communautés religieuses féminines sans clôture, Saint-Etienne, Publications de l'Université Saint-Etienne, «C.E.R.C.O.R. Travaux et Recherches», 2003.
- Le Bourgeois, Marie-Amélie, «Une fondatrice d'avant-garde: Anne de Xainctonge et la Compagnie de Sainte-Ursule à Dole», Revue d'Histoire de l'Eglise de France, 80, 204, 1994, p.23-41.
- Positio super virtutibus ex Officio concinnata: Sancti Claudii, Beatificationis et canonizationis servae Dei Annae de Xainctonge, éd. Giovanni Papa, Cité du Vatican, Sacrée Congrégation pour la cause des saints, «Officium historicum», 19, 1972.
- Longchamp Albert, Petite vie d'Anne de Xainctonge, DDB Paris 2010.
Jugements
- «Dès le début, elle embrassa notre compagnie au point qu'elle vint à Dole à l'insu de ses parents, quand les Nôtres furent obligés de quitter Dijon, afin d'user des Pères de Dole pour le soin de son âme. Rien ne put la détourner de sa décision, ni les pénuries, ni les menaces des membres de sa famille, ni les avertissements et les objurgations des Recteurs. Elle resta ferme dans sa décision, au milieu des douleurs presque perpétuelles: podagre, calcul, céphalalgie et autres maladies. En mourant, elle légua vingt pièces d'or aux Collèges de chacune des quatre villes dans lesquelles elle avait vécu.» («Commentaire de l'annaliste du collège des Jésuites de Dole» [1621], dans Marie-Amélie Le Bourgeois, «Une fondatrice d'avant-garde», voir supra, choix bibliographique, p.31).
- «Toutes fois, avec prudance, comme ie luy es veut pratiquer plusieurs fois de sa charité envers le prochain, elle estoit telle qu'elle ne trouvoit aucun travoux difficile pour le salut spirituel ou corporel de ces prochains; comme elle l'a faict paroistre en l'établicement de nostre Compagnie, en l'instruction des filles, où elle s'emploioit ordinairement avec beaucoup de travoux...» ([Catherine de Saint-Maurice], Quelques points remarquables de la vie de la sœur Anne de Xainctonge… [1623-1629], dans Marie-Amélie Le Bourgeois, Les ursulines d'Anne de Xainctonge, voir supra, choix bibliographique, p.321).
- «Ce sont petittes fantaisies de filles, qui pour s'affranchir de la subiection qu'on doit à une mère, veulent entrer en religion. Et puis elle nous entretient icy de ie ne sçai quelles idées inouyes de faire des ursulines, d'estre maistresse d'échole et de vivre sans cloistre, comme si iamais on avoit veu des filles vivantes en communauté sans estre enfermée. Quand il faudroit passer par là, voudroit il pas bien mieux choisir quelque bonne religion des anciennes, qu'en fabriquer une nouvelle. Et à tout rompre, s'il en falloit faire une, seroit il pas plus à propos de l'establir à Dijon, où elle pourroit donner de l'exemple à ceux de sa ville, servir sa patrie et consoler ses parents? Qui iamais approuvera cette extravagance, qu'une damoiselle de Dijon s'en aille au Conté de Bourgogne commencer une congrégation d'ursulines, en ce temps où tout est suspect? Quel mistère fera t-on là dessus, lors qu'on dira que la fille d'un conseiller quitte la France pour aller en une ville d'Espagne, fonder, pour le dire ainsy, des colonies nouvelles?» («Commentaire de Jean de Xainctonge, père d'Anne», Archives des Ursulines de Dole, La vie parfaitement humble et courageuse d'Anne de Xainctonge, institutrice des ursulines du conté de Bourgogne… par Étienne Binet s.j. [1636], f.51-52 -- reproduit dans Marie-Amélie Le Bourgeois, Les ursulines d'Anne de Xainctonge, voir supra, choix bibliographique, p.307).
- «Même lorsque [les fondatrices] ont joué un rôle déterminant dans la création d'une nouvelle famille religieuse, elles apparaissent habituellement dans l'histoire comme des exécutantes sous la coupe, de protection ou de contrôle, d'un homme [...]. Il y a des exceptions où la femme qui a eu l'intuition d'une institution originale tient ferme contre toute tentative de gauchissement. Anne de Xainctonge avec ses Ursulines de Dole est un bon exemple de cette forme de “résistance” [...]. On a bien affaire, ici, à l'un des bouleversements qui, sans théâtralité, ni scandale, ont modifié -lentement mais en profondeur- les comportements chrétiens [...]. La requête d'Anne de Xainctonge [à l'Archevêque de Besançon en janvier 1606] marque à la fois une prise de conscience par des femmes des limites que l'attitude des évêques français était capable de mettre à leurs résolutions, et une belle persévérance à poursuivre leurs desseins. Sa démarche dénote aussi ses capacités d'adaptation aux conditions politiques locales, puisque, pour faire aboutir son projet, Anne n'hésite pas à placer sa première implantation à Dole, en Franche-Comté, sous obédience espagnole, alors qu'en France, son propre père, conseiller au parlement de Dijon, disposait de suffisamment d'appuis pour faire éventuellement échouer la tentative. Elle révèle enfin une intelligente souplesse, puisque Anne et ses compagnes, respectant en cela la bienséance la plus “classique”, que ce soit par conviction ou par tactique, s'engagent à garder la “modestie”, vertu cardinale que l'on attend de l'honnête femme, inculquée par les familles aussi bien que par les couvents.» (Marcel Bernos, Femmes et gens d'Eglise,voir supra, choix bibliographique, p.317-318).
Source: http://www.siefar.org/dictionnaire/fr/Anne_de_Xainctonge